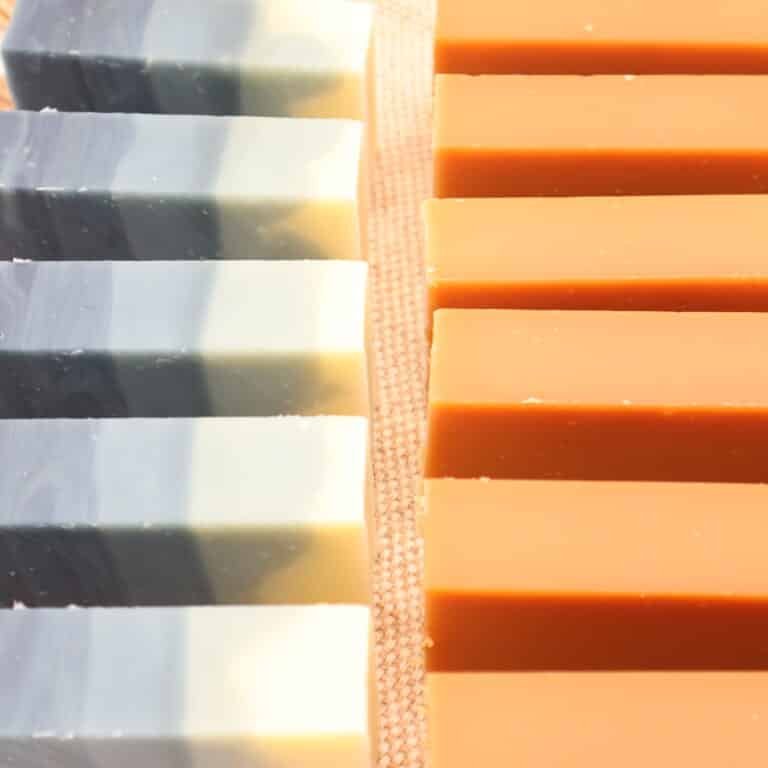Le vocabulaire de la saponification
Je vous ai fait ici un petit condensé du vocabulaire de la saponification.
Il ne se veut pas exhaustif, les définitions ont été simplifiées pour une meilleure compréhension. Cela vous aidera à mieux appréhender les termes que vous allez rencontrer lorsque vous voulez vous lancer dans le monde de la saponification. Bonne lecture !
A
Acide gras
Chaîne carbonée – saturée ou insaturée – qui constitue les huiles végétales ; son profil influence directement la dureté, la mousse et la douceur du savon, d’où le choix d’huile de coco (très laurique) pour une mousse généreuse.
Affinage
Période de maturation supplémentaire après la cure ; en laissant reposer une barre deux à trois mois, on obtient un savon plus dur, une mousse plus crémeuse et un parfum parfaitement ancré.
B
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)
Ensemble de règles d’hygiène et de traçabilité imposées aux professionnels ; blouse, gants et étiquetage systématique garantissent un atelier propre et des savons sûrs pour l’utilisateur final.
C
Calculateur de savon
Programme qui convertit les indices de saponification en grammes de soude et d’eau ; il permet de créer ses propres formulations de savons en donnant les tendances en terme de dureté, mousse, douceur, etc…et en calculant la soude nécessaire par rapport au surgras que l’on souhaite. Un des plus connus est SoapCalc.
Cendre de soude
Pellicule blanchâtre de carbonate de sodium formée à la surface lorsqu’un savon fraîchement coulé rencontre l’air ; elle n’altère ni la douceur ni la durée d’usage, et se polit ou se rince aisément pour un fini impeccable.
Colorants végétaux et minéraux
Pigments issus d’argiles, d’oxydes ou de poudres de plantes ; ils apportent des marbrages artistiques sans recourir à des colorants synthétiques controversés.
Corps gras
Ensemble des huiles et beurres qui réagissent avec la soude ; l’huile d’olive ou l’huile de tournesol oléique pour la douceur, l’huile de coco pour la mousse et le beurre de karité pour le crémeux composent souvent la base d’un savon équilibré.
Cure
Phase de séchage de quatre à six semaines qui permet à l’eau de s’évaporer et au pH de se stabiliser ; un peu de patience et la barre sera plus dure et plus douce pour la peau.
D
Déphasage (séparation)
Rupture de l’émulsion où la pâte se scinde en huile et gel savonneux ; un mixeur plongeant à température homogène prévient ce phénomène qui donnerait un savon marbré malgré lui.
E
Exfoliants doux
Particules végétales ou minérales (flocons d’avoine, marc de café) incorporées à trace ; elles offrent un gommage léger et transforment la toilette quotidienne en soin sensoriel.
F
FDS (Fiche de Données de Sécurité)
Document réglementaire détaillant les risques et consignes de stockage d’un ingrédient ; dans l’atelier, on s’y réfère avant de manipuler une huile essentielle puissante comme la menthe poivrée.
Fiche technique (FT)
Résumé des propriétés physico‑chimiques d’une matière première ; un simple coup d’œil renseigne sur le point de fusion du beurre de cacao ou la teneur en acides gras saturés.
Fragrance naturelle
Mélange aromatique d’origine végétale sans phtalates ; elle parfume subtilement la barre tout en limitant les allergènes potentiels.
G
Gel phase
Montée en température à environ 60 °C au cœur du savon ; encouragée par l’isolation, elle intensifie les couleurs et donne un fini lustré.
H
Hydrolyse
Scission des triglycérides sous l’action de la soude ; cette transformation chimique produit simultanément savon et glycérine, d’où la douceur caractéristique des savons Savaé.
Huiles essentielles (HE)
Extraits aromatiques très concentrés obtenus par distillation ; dosées en‑deçà de 3 %, elles parfument la barre tout en apportant leurs propriétés aromathérapeutiques.
Huiles végétales
Les huiles végétales sont des corps gras extraits de graines, de fruits ou de noyaux de plantes oléagineuses. Elles sont composées principalement de triglycérides, eux-mêmes constitués d’acides gras de longueurs et de structures variées. Chaque huile possède ainsi une identité unique, définie par son profil en acides gras saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés, ainsi que par sa richesse en insaponifiables (vitamines, antioxydants, phytostérols…).
En savonnerie, les huiles végétales constituent la matière première essentielle à la saponification. Leur composition influence directement les propriétés du savon : dureté, pouvoir moussant, douceur, stabilité, surgraissage. Par exemple, l’huile d’olive donne un savon très doux mais peu moussant, tandis que l’huile de coco apporte beaucoup de mousse mais peut être desséchante à forte dose.
Le choix des huiles permet donc d’orienter la formulation selon les besoins de la peau, le style de savon recherché ou la sensorialité souhaitée. En formulation artisanale, on privilégie les huiles vierges, pressées à froid, pour préserver un maximum de leurs qualités intrinsèques.
I
Indice d’iode (II)
Nombre de grammes d’iode consommés par 100 g d’huile, indicateur de son insaturation ; un indice d’iode élevé annonce un savon tendre (huile de tournesol linoléique par exemple), qu’on compense avec une huile plus saturée pour gagner en dureté.
Indice de saponification (IS)
L’indice de saponification correspond à la quantité de soude nécessaire pour transformer un gramme d’huile en savon. Il est souvent exprimé en milligrammes de potasse (KOH) par gramme d’huile, même si en savonnerie solide on utilise de la soude caustique (NaOH). Chaque huile a un IS propre, lié à sa composition en acides gras. Cette donnée est indispensable pour calculer précisément la quantité de soude dans une recette et éviter un savon trop caustique ou trop gras.
En savonnerie solide, on convertit l’IS en équivalent NaOH pour adapter la recette à la fabrication de savons durs. Par exemple, l’huile de coco a un IS plus élevé que l’huile d’olive, ce qui signifie qu’elle demande plus de soude pour être totalement saponifiée.
C’est une donnée essentielle pour obtenir une texture ferme, stable et agréable à l’usage.
INS
Acronyme d’Iodine Number Saponification, l’INS a été défini en 1927 par E.T. Webb dans son traité « Soap and Glycerine Manufacture ». Il visait à estimer d’un coup d’œil la rapidité de saponification d’un mélange d’huiles et sa capacité à générer une grande quantité de glycérine – autrefois récupérée et commercialisée à part. Cet indice combine des éléments liés à la dureté, la douceur et la stabilité du savon.Aujourd’hui, en savonnerie artisanale, on utilise encore l’INS comme repère pratique pour formuler des savons équilibrés : une valeur comprise entre 150 et 170 permet généralement d’obtenir une barre ni trop molle ni trop cassante, agréable à l’usage et durable dans le temps.
Insaponifiables
Fraction d’une huile qui ne réagit pas avec la soude, riche en vitamines et phytostérols ; elle reste intacte dans le savon fini et nourrit la peau en profondeur. Entre 2 et 10% suivant les huiles végétales ou les beurres utilisés.
L
Lot
Lot de production identifié par un numéro unique ; cette traçabilité permet de reproduire exactement une recette que l’on apprécie ou de retracer la formulation en cas de contrôle qualité.
M
Melt & Pour
Base glycérinée déjà saponifiée que l’on fait fondre pour la couler dans des moules créatifs ; parfait pour les ateliers enfants, car on n’y manipule pas la soude caustique.
P
pH
Mesure de l’alcalinité ; un savon fini affiche un pH entre 8,5 et 10.5, assez doux pour la peau tout en étant parfaitement lavant.
Phase aqueuse / huileuse
Respectivement solution d’eau et de soude, et mélange d’huiles chauffées ; leur rencontre à température similaire est le point de départ de la saponification.
Point de solidification
Température à laquelle un beurre passe de l’état liquide à semi‑solide ; connaître celle du karité évite les grains dans la pâte lorsqu’il se fige trop tôt.
Potasse (KOH)
Hydroxyde de potassium utilisé pour les savons liquides ou les pâtes de rasage ; il confère une texture crémeuse facile à rincer.
R
Ratio soude/eau
Rapport entre la quantité de soude dissoute et le volume d’eau utilisé ; plus la part de soude est élevée (ratio serré), plus la pâte trace rapidement et permet un démoulage express, tandis qu’un ratio plus large ralentit la réaction et laisse davantage de temps pour les marbrages complexes.
Retrait de soude
Réduction volontaire de 5 à 10 % de la soude théorique ; cette marge crée un surgraissage nourrissant qui laisse la peau souple après la douche.
Rivières de glycérine
Veines translucides créées par une phase gel partielle ; cet effet visuel n’affecte ni la dureté ni la douceur de la barre, il ajoute même un charme marbré naturel.
S
Saponification
Réaction alcaline qui décompose les triglycérides des huiles en savon et glycérine ; c’est le cœur même du métier de savonnier.
Saponification à froid (SAF)
Version douce, réalisée en dessous de 40 °C, qui préserve les propriétés des huiles et génère naturellement de la glycérine super‑hydratante.
Saponification à chaud
Méthode de saponification à chaud où la pâte est cuite entre 70 et 90 °C jusqu’à réaction complète ; le savon est prêt en 24 heures, avec une texture plus rustique idéale pour les barres exfoliantes.
Seizing
Solidification soudaine de la pâte, souvent due à une fragrance réactive ; il faut alors mouler en urgence ou diluer pour sauver la fournée.
Soude (NaOH)
Hydroxyde de sodium qui, dissout dans l’eau, produit une réaction fortement exothermique ; une fois la saponification achevée, il ne reste plus de soude libre dans la barre.
Surgraissage
Excédent d’huile non saponifiée (généralement 5 à 15 %) qui reste disponible pour nourrir la peau ; c’est le secret des savons très doux.
T
Température de fusion
Point où un beurre devient entièrement liquide.
Trace
Moment clé où la pâte épaissit suffisamment pour laisser un sillage visible à la surface ; c’est l’indicateur que la saponification a bien démarré. On parle de trace fine quand la pâte reste fluide comme une crème légère : on profite alors de sa souplesse pour réaliser des marbrages complexes ou intégrer des couleurs liquides sans qu’elles figent. La trace moyenne se reconnaît à la texture d’une crème dessert ; la pâte coule encore, mais elle tient ses dessins, idéale pour un swirl net et un démoulage rapide. Enfin, la trace épaisse évoque une mayonnaise souple : elle permet de sculpter des reliefs, de poser des toppings ou de créer des inserts 3D sans que la forme ne s’affaisse.
Voilà nous avons terminé notre tour d’horizons du vocabulaire de la saponification.